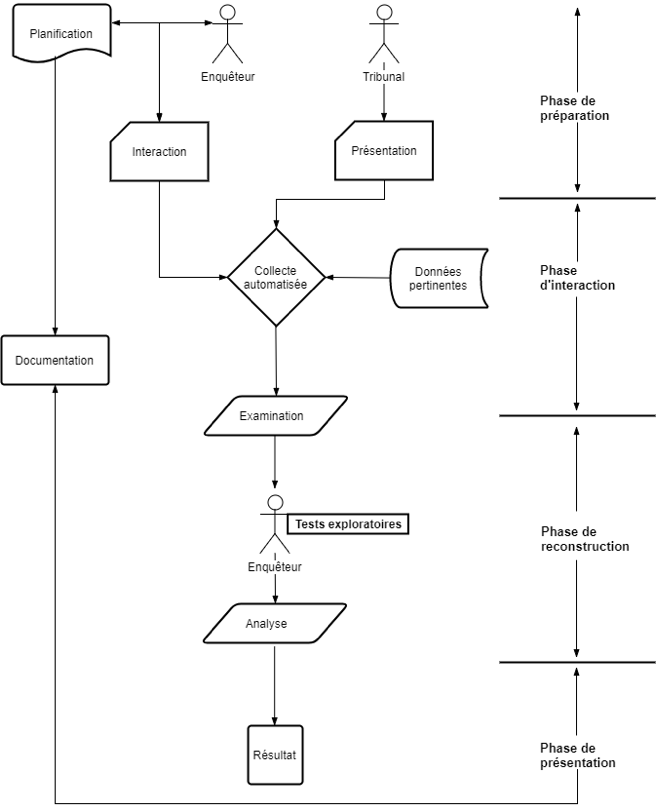Procédure d’enforcement de la FINMA en matière d’abus de marché : quelles garanties procédurales applicables ?
De Fanny Margairaz
Le 23 juin 2017, la FINMA annonçait avoir clos une procédure d’enforcement portant sur de graves cas d’abus de marché dirigée contre un ancien membre de conseils d’administration de différentes entreprises industrielles suisses : des violations répétées et systématiques de l’interdiction posée par le droit de la surveillance d’utiliser des informations d’initié (art. 142 LIMF[1]) furent constatées et des gains indûment acquis confisqués à hauteur de 1,4 million de francs[2].
Par arrêt du 29 juin 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le « TAF ») a confirmé la décision de la FINMA, tout en réduisant le montant de la confiscation à 1,2 million de francs[3].
Outre le caractère record des sommes confisquées, cet arrêt est intéressant parce qu’il s’agit du premier cas dans lequel la FINMA a sanctionné des violations du droit de la surveillance commises par un particulier qui n’exerçait pas dans un établissement soumis à sa surveillance prudentielle, compétence qu’elle détient en matière d’abus de marché depuis le 1ermai 2013 (art. 34 aLBVM, aujourd’hui 145 LIMF).
C’est donc également la première fois que le TAF a eu l’occasion de se prononcer sur la nature de la procédure d’enforcement menée par la FINMA dans le cadre de cette nouvelle compétence au regard de l’article 6 CEDH.
Pour mémoire, l’article 6 CEDH trouve application en présence d’une « accusation en matière pénale » (art. 6 al. 1 CEDH). De jurisprudence constante, l’existence ou non d’une telle accusation s’apprécie de manière autonome sur la base de trois critères, dits « critères Engel »[4], à savoir : 1) la qualification juridique de l’infraction en droit interne, 2) la nature même de l’infraction en droit interne, et enfin 3) le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé[5]. La qualification de la procédure en droit interne n’est donc pas déterminante et l’article 6 CEDH peut s’appliquer à des procédures que le droit interne qualifie par exemple d’administratives, si l’un ou l’autre des autres critères, alternatifs, est rempli.
La question a son importance puisqu’en cas de reconnaissance de la nature « pénale » au sens de l’article 6 CEDH de ce type de procédure d’enforcement, la FINMA se verrait contrainte de respecter les garanties procédurales qui en découlent, soit en particulier la présomption d’innocence, le principe in dubio pro reo, ou encore le droit de ne pas s’auto-incriminer. Or ces garanties entrent directement en conflit avec plusieurs principes régissant la procédure administrative, et en particulier l’obligation de collaborer imposée aux parties par l’article 29 LFINMA, sans laquelle l’activité de la FINMA serait fortement compliquée.
Dans l’arrêt précité, les recourants, soit l’ancien membre des conseils d’administration et sa société, se plaignaient précisément de ce que la FINMA avait retenu contre eux un manque de collaboration et violé de ce fait leur droit de ne pas s’auto-incriminer garanti notamment par l’article 6 CEDH. Le délit d’initié de l’article 142 LIMF constituait selon eux une « accusation en matière pénale » au sens de cette dernière disposition, de sorte que les garanties procédurales en découlant devaient leur être appliquées.
Sans les nommer expressément, le TAF analyse brièvement les deuxième et troisième critères précités (l’article 142 LIMF n’étant pas classé parmi les dispositions pénales de la LIMF, le premier critère n’est à l’évidence pas rempli). Sur la nature de l’infraction d’abord, le TAF relève que, contrairement à une infraction pénale, l’article 142 LIMF n’a pas pour objectif la répression d’un comportement fautif, mais uniquement la protection et l’égalité de traitement des acteurs du marché ainsi que la garantie du bon fonctionnement des marchés financiers[6]. Sur la question des sanctions ensuite, le TAF considère que la confiscation prononcée ne constitue pas une sanction au sens pénal, dans la mesure où elle a pour seul objectif de rétablir une situation conforme au droit[7]. Il en conclut que ni la norme de droit de la surveillance relative au délit d’initié ni la confiscation prononcée ne constituent une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 CEDH, de sorte que ce dernier n’est pas applicable.
Ces considérants ne sont à notre sens pas totalement satisfaisants, dans la mesure où ils omettent un certain nombre d’éléments.
S’agissant en premier lieu du critère de la nature de l’infraction, la jurisprudence considère en effet qu’est déterminant pour distinguer une norme pénale d’une norme disciplinaire le cercle des personnes concernées : lorsque la réglementation s’adresse, à tout le moins potentiellement, à l’ensemble de la collectivité, il s’agit d’un indice en faveur du caractère pénal de la norme[8]. En outre, le fait que le comportement visé puisse également être sanctionné pénalement constitue un autre indice en faveur de l’application de l’article 6 CEDH[9].
Or, contrairement au droit de la surveillance classique, l’article 142 LIMF ne s’adresse pas uniquement aux assujettis, mais vise bien « toute personne » qui le violerait (art. 145 LIMF). Le comportement qu’il sanctionne est en outre également pénalement réprimé par l’article 154 LIMF, les éléments constitutifs des deux dispositions se recoupant très largement. Il n’est donc pas exclu que l’infraction en elle-même ait un caractère pénal au sens de l’article 6 CEDH.
S’agissant ensuite du critère de la gravité de la sanction, la CEDH précise que la coloration pénale d’une procédure est subordonnée au degré de gravité de la sanction dont est a priori passible la personne concernée, et non à la gravité de la sanction finalement infligée[10].
Or, dans le cas d’espèce, la confiscation prononcée n’était pas la seule sanction qu’encouraient les recourants : à teneur de l’article 145 LIMF, leur étaient en particulier également applicables les instruments de surveillance prévus aux articles 32 (décision en constatation) et 34 LFINMA (publication d’une décision en matière de surveillance)[11]. Et comme le relève la doctrine, « il ne semble pas possible d’exclure d’emblée qu’une décision en constatation (et a fortiori la publication de cette décision) soit qualifiée de pénale au sens de l’art. 6 CEDH »[12]. La CEDH a en effet jugé qu’un simple blâme prononcé par la Commission bancaire française, mesure relativement proche d’une décision de constatation de la FINMA, constituait déjà une accusation en matière pénale[13]. Quant à la publication d’une telle décision, le Tribunal fédéral a jusqu’à présent laissé la question ouverte[14]. Une telle publication a toutefois en partie une portée infamante (l’expression « naming & shaming » est à cet égard parlante) pouvant dépasser la simple prévention de la répétition de l’infraction et devenir punitif, de même qu’elle peut gravement affecter l’avenir économique des personnes concernées, autant d’indices qui pourraient également plaider en faveur de la reconnaissance du caractère pénal d’une telle sanction[15].
Ces différents éléments ne sont malheureusement pas examinés par le TAF dans l’arrêt examiné. Nous ne pouvons qu’espérer qu’un recours ait été déposé à son encontre et que le Tribunal fédéral saisisse cette occasion pour clarifier de manière plus convaincante ces questions importantes.
[1] Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, RS 958.1.
[2] Communiqué de presse de la FINMA du 23 juin 2017, https://www.finma.ch/fr/news/2017/06/20170623-mm-marktverhalten/.
[3] Arrêt du Tribunal administratif fédéral, B-4763/2017, du 29 juin 2018.
[4] Arrêt de la CEDH « Engel et autres c. Pays-Bas », du 8 juin 1976.
[5] Arrêt de la CEDH « Dubus S.A. c/ France », du 11 juin 2009.
[6] Arrêt du Tribunal administratif fédéral, B-4763/2017, du 29 juin 2018, consid. 3.3.
[7] Arrêt du Tribunal administratif fédéral, B-4763/2017, du 29 juin 2018, consid. 3.3.
[8] Arrêt du Tribunal fédéral 8C_417/2010 du 6 septembre 2010, consid. 4.2.2.
[9] Arrêt du Tribunal fédéral 8C_417/2010 du 6 septembre 2010, consid. 4.2.2.
[10] Arrêt de la CEDH « Dubus S.A. c/ France », du 11 juin 2009, consid. 37.
[11] Mais non l’article 33 LFINMA (interdiction d’exercer).
[12] Jacques IFFLAND, Les procédure d’enforcement de la FINMA, ou de la difficulté de coordonner les procédures coercitives administratives et les procédures pénales sous l’empire du nouveau CPP et de la LFIMNA, in : THEVENOZ/BOVET (éd.), Journée 2010 de droit bancaire et financier, 2011, p. 134. Notons toutefois que le caractère pénal d’une interdiction d’exercer (art. 33 LFINMA), sanction a priori plus grave, a été nié par le Tribunal fédéral (ATF 142 II 243, consid. 3.4., in JDT 2016 I 112). D’un avis contraire, not. : Guillaume BRAIDI, L’interdiction d’exercer selon l’art. 33 LFINMA a-t-elle un caractère pénal à l’aune de la CEDH ?, in QfLR 2/14 p. 11, p. 13 ; GOTTINI/VON DER CRONE, Berufsverbot nach Art. 33 FINMAG – Bundesgerichtsurteil 2C_739/2015 vom 25. April 2016, in RSDA 2016, p. 640 ss, p. 647 ; Carlo LOMBARDINI, La protection de l’investisseur sur le marché financier, 2012, p. 422, no 48.
[13] Arrêt de la CEDH « Dubus S.A. c. France », du 11 juin 2009, consid. 38.
[14] Arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2011 et 2C-543/2011, du 12 janvier 2012, consid. 5.2.2. Pour le caractère pénal d’une telle publication : B-3759/2014 du 11.05.2015 consid. 4.1.2 ; B-5540/2014 du 02.07.2015, consid. 7.4.
[15] Carlo LOMBARDINI, La protection de l’investisseur sur le marché financier, 2012, p. 422, no 52.
![]()